JURILO - Notre Chat Bot
à l'œuvre
1. Posez votre question juridique – en langage clair
2. Recevez des réponses structurées et vérifiées – instantanément
3. Agissez en toute confiance – grâce à des sources transparentes
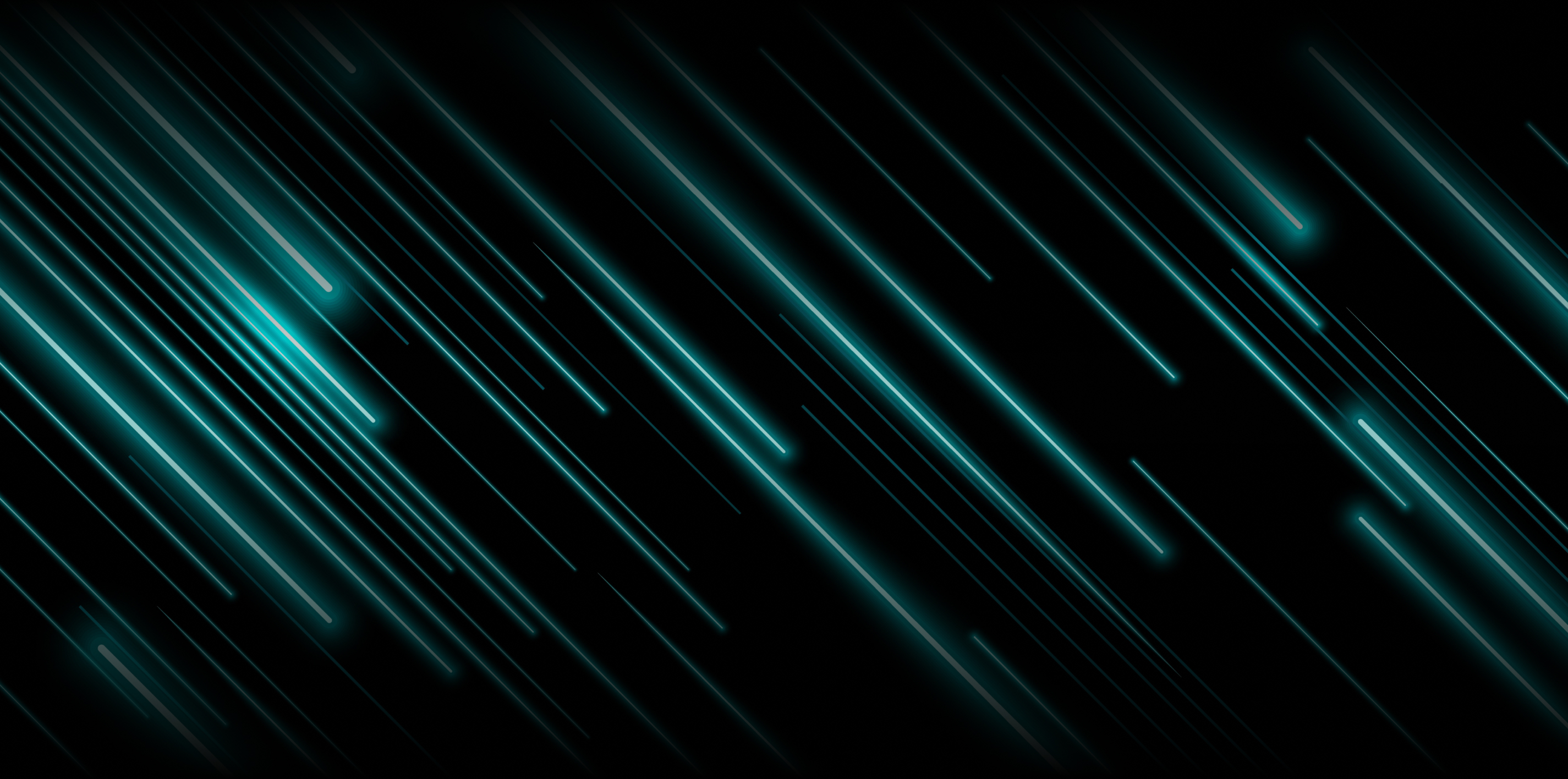
Un licenciement immédiat justifié exige un motif grave. Est considérée comme motif grave toute circonstance dont la présence ne permet plus d'exiger de bonne foi de celui qui donne le congé la poursuite de la relation de travail. Il faut une faute particulièrement grave ou une violation des obligations contractuelles de travail, faute de quoi la poursuite de la relation de travail est considérée comme supportable pour la durée du délai de congé ordinaire. La faute doit être objectivement propre à détruire ou à ébranler gravement la relation de confiance entre les parties. De plus, une telle destruction ou grave atteinte doit effectivement exister. Enfin, un licenciement immédiat doit être prononcé sans délai, en règle générale dans un délai maximum de 2 à 3 jours ouvrables.
S'il n'existe pas de motif grave, un licenciement immédiat reste néanmoins valable. Il doit alors cependant être qualifié d'injustifié.
Conséquences juridiques :
Un licenciement immédiat met fin à la relation de travail dans tous les cas avec effet immédiat. S'il est cependant injustifié, le travailleur licencié a droit à des dommages-intérêts correspondant au gain qui lui a échappé pendant le délai de congé ordinaire ou jusqu'à l'échéance d'un contrat de travail à durée déterminée. En outre, une indemnité pouvant aller jusqu'à six salaires mensuels peut lui être accordée, dont le montant dépend de la faute de l'employeur. Si en revanche un travailleur prononce un licenciement immédiat injustifié, l'employeur peut exiger une indemnité correspondant au quart du salaire mensuel ainsi que, le cas échéant, réparation pour tout autre dommage survenu.
Un licenciement justifié sans préavis nécessite un motif important. Toute circonstance dont, de bonne foi, on ne peut plus s'attendre à ce que la relation de travail se poursuive doit être considérée comme une raison importante. Il s'agit d'une faute particulièrement grave ou
La violation des obligations du contrat de travail est nécessaire, sinon la poursuite de la relation de travail pendant la durée de la période de préavis ordinaire est considérée comme raisonnable. La faute doit être objectivement susceptible de détruire ou d'ébranler sérieusement la relation de confiance entre les parties. De plus, une telle destruction ou de fortes secousses doivent réellement se produire. Enfin, la résiliation sans préavis doit être prononcée immédiatement, généralement dans un délai maximum de 2 à 3 jours ouvrables.
S'il n'y a pas de raison importante, la résiliation sans préavis est toujours valable. Cependant, elle doit ensuite être qualifiée d'injustifiée.
Conséquences juridiques :
Dans tous les cas, la résiliation sans préavis mettra fin immédiatement à la relation de travail.
Si le licenciement sans préavis n'est pas justifié, le salarié licencié peut prétendre à une indemnisation à hauteur de la perte de revenus pendant la période de préavis ordinaire ou jusqu'à l'expiration d'un contrat à durée déterminée.
L'employé peut également bénéficier d'une indemnité pouvant aller jusqu'à 6 mois de salaire. Le montant de l'indemnisation dépend de la faute.
Si le licenciement immédiat d'un salarié n'est pas justifié, l'employeur peut demander une indemnité correspondant au quart du salaire mensuel et, si nécessaire, une indemnisation pour les dommages supplémentaires qu'il a subis.
Tout contrat de travail peut être résilié d'un commun accord par un accord de résiliation (art. 115 CO). Celui-ci n'est soumis à aucune exigence de forme et peut également être conclu tacitement, bien que la forme écrite soit vivement recommandée pour des raisons de preuve. La condition préalable est un accord de volonté clair et indubitable des parties pour mettre fin à la relation de travail ; en particulier, une renonciation du travailleur à des droits existants ne doit pas être admise à la légère. Selon l'art. 341 al. 1 CO, une renonciation du travailleur à des créances légalement impératives pendant la relation de travail et jusqu'à un mois après sa fin est inadmissible. Par conséquent, lors d'un accord de résiliation, il convient d'examiner particulièrement si une indemnisation appropriée est accordée pour des droits déjà acquis comme les vacances ou les heures supplémentaires. La plupart des dispositions d'un accord de résiliation concernent cependant des droits futurs, comme la renonciation aux délais de protection contre le licenciement selon l'art. 336c CO, où même dans ce cas, en cas de renonciation, une contre-prestation appropriée – par exemple une indemnisation financière – est requise. Une résolution de contrat sans respect du délai de congé est admissible si l'employeur renonce à la prestation de travail et le travailleur au salaire pendant cette période, les concessions mutuelles et un éventuel intérêt propre du travailleur à la résolution étant déterminants. Si l'accord de résiliation intervient à la demande du travailleur, cela est considéré comme une démission, ce qui peut entraîner dans le cadre de l'assurance-chômage selon l'art. 30 LACI, une suspension des prestations d'indemnités journalières pouvant aller jusqu'à 60 jours.
Tout contrat peut être résilié d'un commun accord (Art. 115 OR). Le contrat de résiliation n'est soumis à aucune exigence formelle particulière et peut également être conclu tacitement. Pour des raisons de preuve, l'écriture est fortement recommandée. L'accord visant à mettre fin à la relation de travail doit être clair et incontestable.
En particulier, si le salarié renonce à ses droits, son consentement ne doit pas être accepté facilement.
Lien avec l'interdiction de renonciation : pendant la durée de la relation de travail et jusqu'à un mois après sa cessation, le salarié ne peut pas renoncer aux réclamations découlant de dispositions indispensables de la loi (art. 341, al. 1 OR). L'interdiction de renonciation s'applique si la réclamation de l'employé est fondée sur une disposition légale impérative. Si un contrat de licenciement contient des accords relatifs à des réclamations obligatoires déjà survenues, telles que l'indemnisation des vacances ou des heures supplémentaires, il est nécessaire de vérifier séparément si l'employeur fournit une indemnisation adéquate à cet égard.
Cependant, la plupart des accords contenus dans un accord de résiliation sont effectifs pour l'avenir, y compris la suppression des délais de préavis bloquants (Art. 336c OR). Si l'employé renonce aux réclamations obligatoires dans le cadre de l'accord de licenciement, cela doit être compensé de manière adéquate par l'employeur, par exemple au moyen d'une compensation financière pour la protection contre la période de blocage.
La résiliation du contrat sans respect du délai de préavis peut être considérée comme recevable si l'employeur renonce au travail et que le salarié renonce au salaire pendant la période de préavis. Les concessions mutuelles et la question de savoir si le salarié a un intérêt personnel à résilier le contrat de travail sont déterminantes. Un accord de licenciement à la demande du salarié est qualifié d'auto-résiliation. En cas de chômage volontaire, la caisse d'assurance chômage peut ordonner la suppression des indemnités journalières pendant une durée maximale de 60 jours (art. 30 AVIG).
Pour s'assurer qu'un bonus soit considéré comme une gratification volontaire et qu'ainsi aucun droit légalement exigible ne naisse, une attention particulière est requise lors de la formulation d'une clause de bonus. La clause devrait expressément stipuler qu'il s'agit d'une prestation volontaire de l'employeur, qui ne constitue pas un élément de salaire fixe et qui est accordée exclusivement selon son libre arbitre. De plus, aucun objectif fixe ou mesurable (par ex. objectifs de chiffre d'affaires ou de bénéfices) ne devrait être inclus, dont la réalisation fonderait automatiquement un droit à des paiements de bonus. Le montant du bonus devrait également rester ouvert et variable, afin de souligner le caractère volontaire. Il est en outre recommandé de prévoir dans la clause un examen et un ajustement annuels par l'employeur. Enfin, il devrait être expressément stipulé que même des paiements répétés ne fondent aucun droit futur et qu'ainsi aucun lien de droit coutumier ne naît.
Afin de garantir qu'un bonus est considéré comme un bonus volontaire et n'y est donc pas légalement éligible, les points suivants doivent être pris en compte lors de la formulation d'une clause de bonus :
Clarification du caractère volontaire : La clause doit indiquer expressément que la prime est un avantage volontaire de l'employeur et ne fait pas partie intégrante du salaire. Il convient de préciser que la prime est accordée à la discrétion de l'employeur.
Aucun engagement quant à des objectifs spécifiques : afin d'éviter que la prime ne soit considérée comme faisant partie d'un salaire, la clause ne doit pas contenir d'objectifs ou de conditions fixes, dont la réalisation entraîne automatiquement une demande de bonus. En particulier, aucun objectif clairement mesurable ne doit être formulé (par exemple, limites de ventes ou de bénéfices).
Variabilité du montant : le montant du bonus doit être variable et non fixe. Cela souligne le caractère volontaire et empêche que la prime soit interprétée comme une partie fixe du salaire.
Révision annuelle : il peut être utile d'indiquer dans la clause que le système de bonus peut être revu et ajusté chaque année par l'employeur afin de mettre l'accent sur le caractère volontaire.
Absence de pratique du droit coutumier : afin d'éviter que le droit commun ne découle de paiements répétés, la clause devrait indiquer clairement qu'aucune réclamation n'est possible pour l'avenir, même en cas de paiement répété.
Les conditions pour une clause de concurrence selon les art. 340 ss CO peuvent être résumées comme suit:
Conditions formelles :
1. Convention écrite (art. 340 al. 1 CO)
2. Capacité d'exercice des droits civils du travailleur (art. 340 al. 1 CO)
Conditions matérielles :
1. Connaissance du travailleur de : - la clientèle et/ou - des secrets de fabrication et d'affaires
2. Possibilité d'un préjudice considérable à l'employeur par l'utilisation de ces connaissances (art. 340 al. 2 CO)
Restrictions :
1. Selon l'art. 340a al. 1 CO limitation appropriée selon : - le lieu – le temps (légalement maximum 3 ans) - l'objet
2. Aucune entrave inéquitable à l'avancement économique du travailleur
Les exigences relatives à une clause de non-concurrence conformément aux art. 340 et suivants OU peut être résumé comme suit :
Exigences formelles :
1. Accord écrit (art. 340, al. 1 OR)
2. Capacité d'action des employés (art. 340, al. 1 OR)
Exigences de fond :
1. Informations des employés sur : - La clientèle et/ou les secrets de fabrication et commerciaux
2. Possibilité de dommages importants pour l'employeur du fait de l'utilisation de ces connaissances (art. 340, al. 2 OR)
Restrictions :
1. Conformément à l'article 340a (1) OU Limitation appropriée selon :
- Lieu et heure (maximum 3 ans selon la loi)
- Article
2. Aucun obstacle indu au progrès économique de l'employé
L'obligation de maintien du salaire de l'employeur malgré l'existence d'une assurance indemnités journalières maladie dépend de savoir s'il a conclu une solution d'assurance équivalente et si les conditions formelles sont remplies :
Si les prestations d'assurance couvrent au moins 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours, cela est considéré comme équivalent à l'obligation légale de maintien du salaire. Les primes pour l'assurance indemnités journalières maladie doivent être prises en charge au moins pour moitié par l'employeur. Pendant un éventuel délai d'attente, l'employeur doit payer au moins 80% du salaire. 2-3 jours de carence sont cependant en principe admissibles. La convention d'une solution d'assurance indemnités journalières maladie doit être faite par écrit.
Si ces conditions sont remplies, la solution d'assurance est considérée comme équivalente et l'employeur est libéré de son obligation de maintien du salaire. Si l'un des points mentionnés n'est pas rempli, la solution d'assurance n'est pas considérée comme équivalente et l'employeur reste obligé au maintien du salaire selon l'art. 324a CO, même si une assurance indemnités journalières maladie existe et fournit éventuellement même des prestations.
L'obligation de l'employeur de continuer à payer les salaires malgré l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie existante dépend de la question de savoir s'il a souscrit une solution d'assurance équivalente et si les conditions formelles ont été remplies :
Si les prestations d'assurance couvrent au moins 80 % du salaire pendant 720 jours sur une période de 900 jours, cela est considéré comme équivalent à la poursuite légale du paiement du salaire.
Au moins la moitié des primes de l'assurance indemnités journalières de maladie doivent être payées par l'employeur. Pendant toute période d'attente, l'employeur doit payer au moins 80 % du salaire. Cependant, 2 à 3 jours d'attente sont généralement autorisés. Une solution d'assurance contre les indemnités journalières de maladie doit être convenue par écrit.
Si ces conditions sont remplies, la solution d'assurance est considérée comme équivalente et l'employeur est dispensé de continuer à payer les salaires. Si l'un des points ci-dessus n'est pas rempli, la solution d'assurance n'est pas considérée comme équivalente et l'employeur reste obligé de continuer à payer les salaires conformément à l'article 324a OU, même s'il existe une assurance d'indemnités journalières de maladie et peut même fournir des prestations.
En principe, un travailleur peut exercer une activité accessoire même avec un taux d'occupation de 100%. Cependant, il existe d'importantes restrictions:
1. Obligation de fidélité (art. 321a CO) :
Le travailleur ne doit pas faire concurrence à l'employeur principal - La prestation de travail dans l'emploi principal ne doit pas être compromise - Les intérêts légitimes de l'employeur ne doivent pas être compromis
2. Obligation d'autorisation :
De nombreux contrats de travail contiennent une clause qui prévoit une obligation de déclaration ou d'autorisation pour les activités accessoires - L'employeur peut interdire l'activité accessoire pour de justes motifs
3. Temps de travail (Loi sur le travail ; LTr) :
La durée maximale hebdomadaire de travail de 45 resp. 50 heures (selon la branche) doit être respectée même en incluant l'activité accessoire - Les temps de repos prescrits doivent être garantis
En principe, un employé peut avoir un travail parallèle même avec une charge de travail de 100 %. Il existe toutefois des limites importantes :
1. Devoir de loyauté (art. 321a OR) :
- Le salarié ne doit pas entrer en concurrence avec l'employeur principal
- Les performances professionnelles dans l'emploi principal ne doivent pas être affectées
- Les intérêts légitimes de l'employeur ne doivent pas être affectés
2. Obligation d'autorisation :
- De nombreux contrats de travail contiennent une clause qui prévoit une obligation de déclaration ou une autorisation pour un emploi secondaire
- L'employeur peut interdire l'emploi secondaire pour des raisons importantes
3. Temps de travail (Code du travail ; ArG) :
- La durée de travail hebdomadaire maximale de 45 ou 50 heures (selon le secteur) doit être respectée, y compris pour les emplois secondaires
- Les périodes de repos prescrites doivent être garanties
Dans le droit du travail suisse, il n'existe en principe aucun droit ni aucune prétention à une indemnité de départ en cas de résiliation ou de dissolution du contrat de travail. Il n'existe pas de base légale au niveau du droit des obligations.
Les exceptions qui peuvent faire naître un droit à une indemnité de départ peuvent être lorsqu'une entreprise dispose d'un plan social qui prévoit des paiements d'indemnités de départ, ou lorsque l'employeur verse des paiements volontaires à un grand nombre de collaborateurs et qu'un employé peut éventuellement dériver une prétention du principe d'égalité de traitement (art. 328 CO). Ce dernier cas constitue toutefois l'exception et ne peut être admis que sous des conditions strictes. De même, dans le domaine du droit du personnel public, diverses lois cantonales sur le personnel prévoient des paiements d'indemnités de départ lors de l'atteinte d'une certaine limite d'âge et d'un nombre spécifique d'années de service (par ex. la loi cantonale zurichoise sur le personnel).
En principe, un employé peut avoir un travail parallèle même avec une charge de travail de 100 %. Il existe toutefois des limites importantes :
1. Devoir de loyauté (art. 321a OR) :
- Le salarié ne doit pas entrer en concurrence avec l'employeur principal
- Les performances professionnelles dans l'emploi principal ne doivent pas être affectées
- Les intérêts légitimes de l'employeur ne doivent pas être affectés
2. Obligation d'autorisation :
- De nombreux contrats de travail contiennent une clause qui prévoit une obligation de déclaration ou une autorisation pour un emploi secondaire
- L'employeur peut interdire l'emploi secondaire pour des raisons importantes
3. Temps de travail (Code du travail ; ArG) :
- La durée de travail hebdomadaire maximale de 45 ou 50 heures (selon le secteur) doit être respectée, y compris pour les emplois secondaires
- Les périodes de repos prescrites doivent être garanties
En principe, les règles suivantes s'appliquent concernant la compensation des heures supplémentaires pendant la dispense de travail:
1. La compensation des heures supplémentaires par du temps libre requiert l'accord du travailleur. Cet accord peut soit résulter déjà du contrat de travail (ou d'un règlement du personnel déclaré partie intégrante) lui-même, s'il a été convenu que les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre et que l'employeur peut ordonner la compensation, soit d'un accord de dispense de travail dans lequel la compensation des heures supplémentaires est convenue.
2. Sans l'accord du travailleur ou sans convention correspondante, les heures supplémentaires ne peuvent pas simplement être considérées comme compensées pendant la dispense de travail. Cela vaut également lorsque l'employeur l'ordonne unilatéralement. Dans ce cas, les heures supplémentaires doivent en principe être payées.
3. En cas de dispense de travail très longue, le refus de compensation par le travailleur.
En principe, les règles suivantes s'appliquent à la rémunération des heures supplémentaires pendant le temps libre :
1. La compensation des heures supplémentaires avec congé nécessite l'accord du salarié. Ce consentement peut résulter soit du contrat de travail lui-même (soit d'un statut du personnel déclaré comme partie intégrante), s'il a été convenu que les heures supplémentaires seront compensées par du temps libre et que l'employeur peut ordonner une indemnisation, soit d'un accord d'exemption dans lequel la compensation des heures supplémentaires est convenue.
2. Sans le consentement du salarié ou sans accord correspondant, les heures supplémentaires pendant le congé ne peuvent pas être simplement considérées comme rémunérées. Cela s'applique même si l'employeur l'ordonne unilatéralement. Dans ce cas, les heures supplémentaires doivent toujours être payées.
3. Toutefois, en cas de congé de très longue durée, le refus d'indemnisation du salarié peut constituer un abus de droit.
Oui, un travailleur peut en principe travailler pendant une dispense de travail, pour autant qu'aucune disposition contractuelle ou légale ne s'y oppose. Un point important est notamment l'interdiction de concurrence en droit du travail. Le travailleur ne peut pas, en raison de son obligation de fidélité, exercer pendant la dispense de travail des activités qui font concurrence aux affaires de l'employeur. Cela vaut indépendamment de l'existence d'une interdiction de concurrence post-contractuelle.
Si le travailleur réalise d'autres revenus pendant la dispense de travail, il doit se les faire imputer sur les paiements de salaire de l'employeur, sauf si les parties ont convenu d'autre chose.
Oui, un salarié peut en principe travailler pendant un congé, à condition qu'il n'existe aucune disposition contractuelle ou légale contraire. Un point important en particulier est l'interdiction de la concurrence en vertu du droit du travail. En raison de son devoir de loyauté, le salarié ne peut pas exercer d'activités qui entrent en concurrence avec l'activité de l'employeur pendant son temps libre. Cela est indépendant de l'existence ou non d'une interdiction de concurrence post-contractuelle.
Si le salarié gagne d'autres revenus pendant son congé, celui-ci doit être imputé sur le salaire de l'employeur, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.
Dans le droit du travail suisse, il n'existe en principe aucune obligation légale pour l'employeur d'avertir un travailleur avant le licenciement. Un avertissement peut cependant être judicieux ou même requis dans certaines situations.
La jurisprudence fait une exception pour les collaborateurs âgés ayant de nombreuses années de service. Ici, la jurisprudence dit que l'employeur a une obligation de sollicitude renforcée envers de tels collaborateurs, raison pour laquelle ceux-ci doivent en règle générale recevoir un délai d'épreuve pour améliorer leurs performances ou leur comportement avant un licenciement. Si l'employeur ne suit pas ces directives, le licenciement peut être qualifié d'abusif. Cela dépend cependant toujours des circonstances du cas d'espèce.
Une autre exception peut être observée en relation avec les licenciements immédiats. En principe, même lors d'un licenciement immédiat pour justes motifs, aucun avertissement préalable n'est requis. Si le travailleur a cependant été averti en raison d'un comportement fautif et qu'il lui a été menacé d'un licenciement immédiat en cas de récidive, un comportement fautif moins grave peut également justifier un licenciement immédiat si le travailleur répète le même comportement fautif.
En droit du travail suisse, il n'existe généralement aucune obligation légale pour l'employeur d'avertir un salarié avant le licenciement. Cependant, un avertissement peut être utile, voire nécessaire dans certaines situations.
La pratique judiciaire pour les employés âgés ayant de nombreuses années de service suppose une exception. En l'espèce, la pratique judiciaire affirme que l'employeur a une obligation de diligence accrue à l'égard de ces employés, raison pour laquelle ils doivent généralement bénéficier d'une période d'essai pour améliorer leurs performances ou leur comportement avant le licenciement. Si l'employeur ne respecte pas ces exigences, le licenciement peut être qualifié d'abusif. Cependant, cela dépend toujours des circonstances de chaque cas.
Une autre exception peut être observée en ce qui concerne les annulations immédiates. En principe, aucun avertissement préalable n'est requis même en cas de résiliation sans préavis pour motif valable. Toutefois, si le salarié a été averti pour faute et a été menacé de licenciement immédiat en cas de récidive, une faute moins grave peut également justifier un licenciement immédiat si le salarié répète la même faute.



